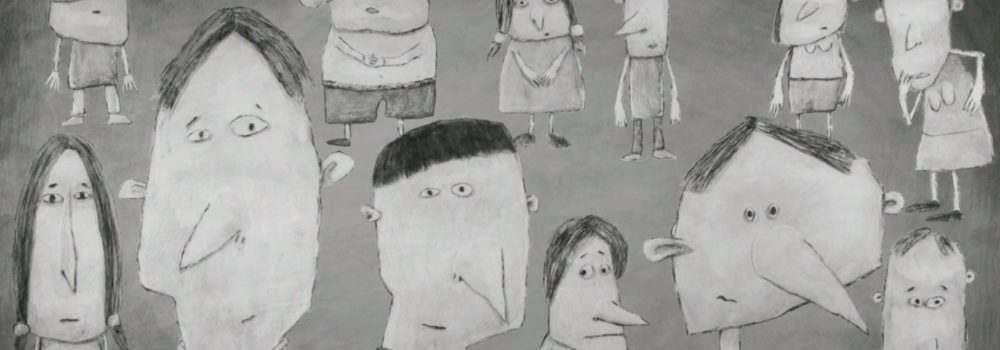RÉDIGER UNE CRITIQUE –
texte de Fabienne PY – cpd 67
Sommaire :
1.La critique de film est partie intégrante de l’univers artistique du cinéma
- La critique = Critiquer ?
- La critique est une profession
- La critique fait vivre le cinéma
- La critique, un exercice d’écriture
2.La rédaction d’une critique
- Il n’existe pas de texte de critique type
- Des attendus dans une critique
3.La critique de film à l’école
- Rédiger une critique
- Acquérir des compétences grâce à la critique
- Connaitre le fondement d’une critique
- Connaitre les matériaux d’une critique
- Enrichir l’analyse des élèves
- Accompagner la rédaction
- Organiser la forme du travail
1.La critique de film est partie intégrante de l’univers artistique du cinéma
- la critique de film = Critiquer ?
Origine du mot « critique » : grec κρίσις krisis = jugement
Selon Jean Douchet, historien du cinéma et critique, le fait d’apprécier, de ressentir et de propager son enthousiasme pour un film constitue un acte critique.
La critique n’est donc pas qu’une opposition à l’œuvre mais plutôt une prise de recul sur l’œuvre, une proposition de lecture du film d’une personne « experte ».
La définition de la critique sur Wikipédia : Le critique de cinéma est une personne qui propose une lecture d’un ou plusieurs films. Cette lecture, également appelée critique, est publiée principalement dans la presse écrite. Il demeure plusieurs façons d’aborder la critique. Une première est celle de l’entrevoir comme un avis et une seconde est de la penser comme une analyse de film. Cependant, nombreux sont ceux qui la restreignent à un simple avis sur un film, celui qui fera qu’ils iront voir, ou non, le film.
- Etre critique est une profession
Le critique de film partage ses enthousiasmes et ses déceptions au public. Il exprime ses avis dans des revues spécialisées, des journaux généralistes, des émissions radiodiffusées ou télévisées, des sites. Il côtoie le monde du cinéma et le monde des médias.
Le critique veut séduire ceux qui le lisent, l’écoutent ou le voient et veut les persuader et les convaincre de partager son avis qu’il argumente et qu’il réfère.
Il existe donc, sous la plume avertie des critiques, différentes approches du même film.
Quelques critiques célèbres
André Bazin (1918-1958), Alain Bergala (1943-), Michel Ciment (1938-), Serge Daney (1944-1992), Louis Delluc (1890-1924) et aussi Godard, Truffaut, Chabrol; les réalisateurs sont souvent aussi critiques
- La critique fait vivre le cinéma
La critique fait vivre le cinéma et traduit sa « bonne » santé.
Elle est un outil de promotion des nouvelles créations et, grâce aux liens qu’elle fait avec d’autres œuvres cinématographiques auxquelles elle se réfère, elle fait vivre le patrimoine filmique. La critique met en tension les films contemporains et les grandes références du domaine, en terme d’œuvres mais aussi d’acteurs, de réalisateurs, de musiques, de décors, de thématiques, etc.
- La critique, un exercice d’écriture
L’écriture d’une critique exige de la créativité dans l’expression et de l’argumentation pour donner un avis.
C’est un exercice qui ne se contente ni de décrire le film, ni de raconter l’histoire, ni même de donner un avis personnel.
Une critique construit l’intelligibilité du film pour son lecteur (ou son auditoire) dans un subtil et sensible mélange entre objectivité et subjectivité.
Le critique doit avoir une belle plume et peut déployer un style très personnel.
La critique est un écrit signé.
2. La rédaction d’une critique
- Il n’existe pas de texte de critique type
La critique ne répond à aucune structure académique ou imposée, ni dans sa forme, ni dans sa teneur. La critique cible un public et sa rédaction s’adapte en fonction de celui-ci.
- Des attendus dans une critique
Si les formes de la critique de film peuvent être mouvantes, son contenu, sans être précisément arrêté est organisé autour d’un certain nombre d’attendus.
On peut dire d’une critique qu’elle comporte :
- Le synopsis du film c’est à dire en quelques lignes le résumé très condensé de la narration
- Une esquisse des personnages principaux, des lieux et du contexte
- La comparaison avec des éléments de référence (des films / des personnages / une thématique)
- Un positionnement personnel
- Quelques informations sur le film (auteur / titre / acteurs / etc.)
Ces différents éléments se combinent selon le choix de l’auteur de la critique.
Par exemple, les données servant de références peuvent accompagner la description des personnages et du contexte mais pourraient aussi, selon l’auteur de l’écrit, ne servir de points d’appui pour donner son avis personnel.
3. La critique de film à l’école
- Rédiger une critique
La critique présente un intérêt notoire dans le cadre des enseignements artistiques et dans le cadre de la maîtrise de la langue :
- Elle oblige les élèves à quitter le narratif pour entrer dans le descriptif
- Elle engage un début d’analyse
- Elle impose de réfléchir au genre et de faire appel à ses connaissances culturelles (faire des liens avec ce que je connais)
- Elle permet de structurer sa pensée et de mettre à jour et en mots des ressentis
- Elle contraint à dépasser le « j’aime/je n’aime pas » pour aller vers un avis affirmé et vers une sensibilité du film
- Elle amène à justifier et à argumenter
- Elle engage dans un écrit autorisant une expression créative, moins conventionnelle
- Acquérir des compétences grâce à la critique
Des compétences dans le domaine artistique
- Distinguer les différentes composantes du film
- Entrer dans une intelligibilité du film
- Analyser des séquences
- Comprendre l’intention du réalisateur
- Des compétences transversales au domaine artistique
Partager et défendre son avis
- Argumenter ses choix
- Rechercher des informations
- Faire des liens entre ses connaissances
- Utiliser un vocabulaire précis et technique
- Synthétiser un récit
- Distinguer des données objectives et des données subjectives
- Exercer des capacités rédactionnelles nouvelles
- Connaitre le fondement d’une critique
Avant de mettre les élèves en situation de rédaction d’une critique, il nous semble avantageux de poser avec eux les enjeux de la critique de film.
Pour sensibiliser les élèves à la critique:
- Lire quelques critiques de films.
- Cette activité s’envisage autour des films programmés et peut s’envisager avant d’aller voir le film, pour se faire une premier avis ou après avoir la séance pour découvrir le regard d’un autre sur le film.
- Cette activité peut s’inscrire dans un rituel autour de la séance de cinéma.
- Les critiques lues peuvent être recueillies dans un classeur collectif.
- Recenser des formes diverses de critiques (en famille / entre amis / dan les médias / etc.)
- Recenser des supports de critiques
- Définir le concept de la critique (à hauteur de compétences d’élèves)
A découvrir, le site Benshi, site de cinéma pour les élèves. Les fiches des films répertoriés font l’objet d’un avis.
- Connaitre les « matériaux » d’une critique
Avant de mettre les élèves en situation de rédaction d’une critique, il nous semble avantageux de déterminer avec eux les contenus attendus d’une critique (à hauteur de compétences d’élèves)
- Prendre appui sur le concept de critique établi pour donner les contenus d’une critique
- Avant la rédaction, définir ensemble le cahier de charge du contenu de la critique pour la classe
- Enrichir l’analyse des élèves sur le film
La qualité de la critique dépend du regard scrutateur du rédacteur sur le film.
La critique sera d’autant plus riche et plus originale si les élèves ont eu du temps pour échanger autour du film mais aussi s’ils ont exploré, après la séance, de séquences choisies, de scènes ou même de photogrammes.
Envisager plusieurs niveaux et plusieurs étapes de réflexion qui peuvent s’appuyer sur les entrées du cahier de charge
- Spontanément, naturellement, les élèves commentent le film dès la sortie de la séance. Cet échange à chaud est intéressant ; il permet de revoir ensemble ce que chacun a vu et de s’enrichir du regard de chacun.
L’enseignant participe à ce moment informel avec sa sensibilité au film. Il prend note des remarques et des avis des élèves.
Si le déplacement du retour vers l’école se fait avec un moyen de transport personnalisé (retour en autocar), l’enseignant peut envisager de coordonner ce moment.
- La scène d’ouverture du film est souvent une scène intéressante pour parler du film. Elle met le spectateur en appétit du film et donne la tonalité du film et souvent son assise. En reparler après la séance permet de nuancer l’ensemble du film. Une réflexion collective autour de cette scène peut offrir de la matière pour la critique.
- Cibler et présenter une séquence à analyser dans sa forme et dans son fond.
- Le site Nanouk, dans son entrée Enseignant, site pédagogique des Enfants du cinéma, partenaire du dispositif Ecole et Cinéma, analyse des séquences (découpage et commentaire) pour chaque film du répertoire.
- Présenter un ou plusieurs photogrammes ciblés.
Pour enrichir le propos, des rôles liés aux métiers du cinéma peuvent être données avant de commenter. Le commentaire se fait alors selon le point de vue de ce rôle (commenter en étant un cameraman / en étant un scénographe décorateur / en étant un compositeur de musique / etc.). Ceci oblige un double regard ; critique et admiratif mais un regard orienté.
- Accompagner la rédaction
- Rappeler que la critique n’est pas le résumé du film et rappeler le cahier de charge des attendus fixé.
- Sélectionner quelques extraits particuliers, évocateurs du film et proposer à l’élève d’en choisir un dont il parlera plus précisément dans sa critique.
- Établir avec les élèves une liste de mots clés qui devront paraître dans la critique.
- Établir une liste de qualificatifs concernant les personnages, les décors, la musique, etc, selon les particularités du film.
- Mettre à disposition le vocabulaire technique (cadrage / point de vue / travelling / etc.) qui aura été engrangé dans un dictionnaire de la classe ou dans un cahier de… de la classe
- Proposer quelques phrases d’entame qui permettent aux élèves de se « lancer » dans l’écriture
La critique rédigée par les professionnels se formalise la plupart du temps après 3 ou 4 écrits «martyrs ».
A l’école, on devrait aussi envisager de ne pas se contenter du premier jet des élèves et améliorer au moins deux versions avant de soumettre la version définitive à son public.
Une autre solution peut être d’institutionnaliser le principe de plusieurs versions par
- un premier jet, spontané juste après la séance.
Cette version a davantage le rôle d’une mise en mémoire des éléments importants du film, des ressentis, des avis et impressions personnels et des avis recueillis auprès d’autres (pour contrebalancer les siens).
- une rédaction plus travaillée dans sa forme mais aussi dans son fond puisque enrichie des analyses et des discussions
- selon la persévérance des élèves et le temps programmé pour l’exercice de la critique, une ultime version travaillée faisant appel à une technicité rédactionnelle (recherche de vocabulaire précis, de synonymes / organisation des enchaînements des idées / rythme de l’écrit / etc.)